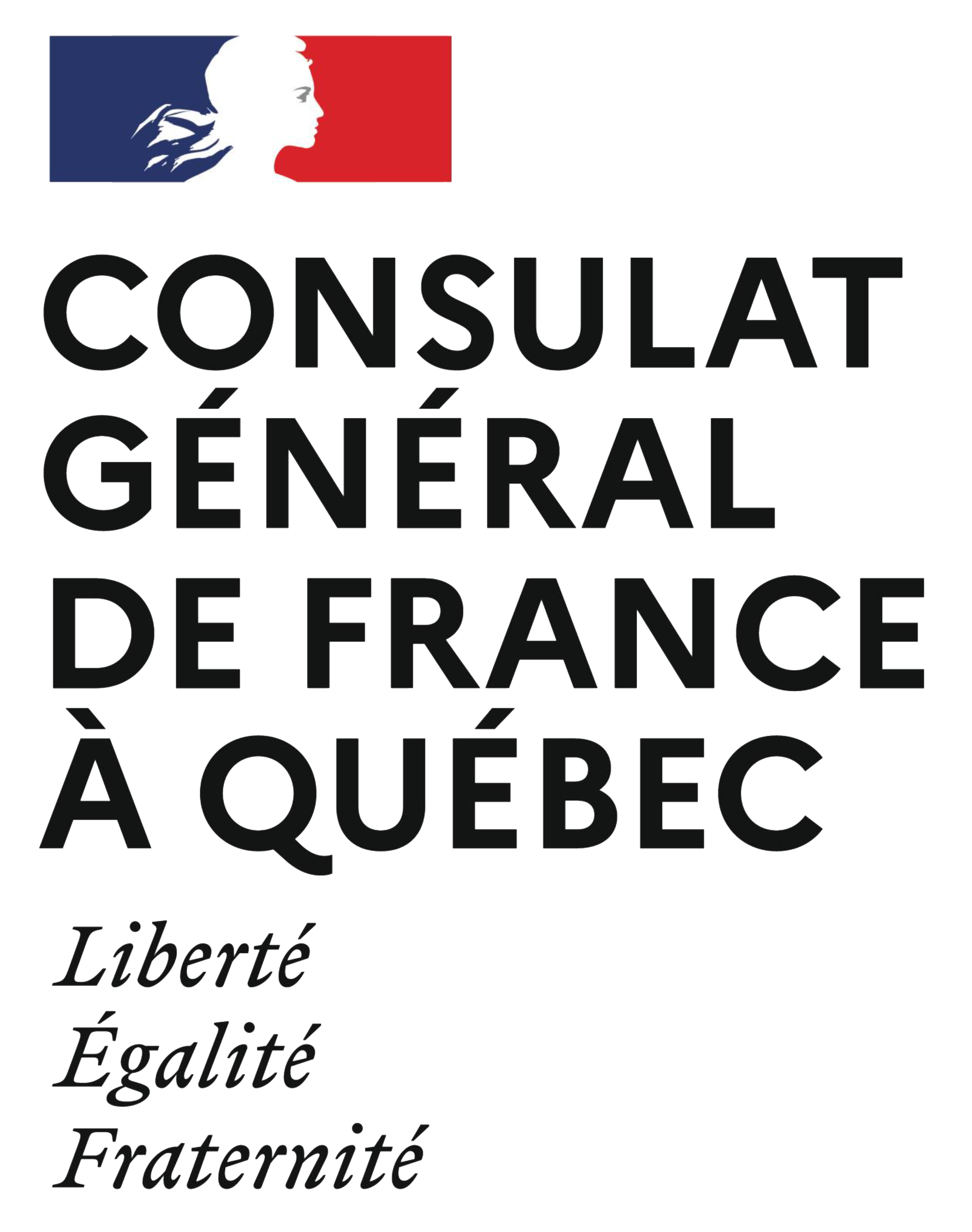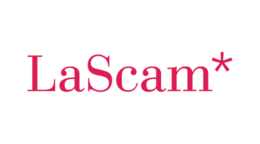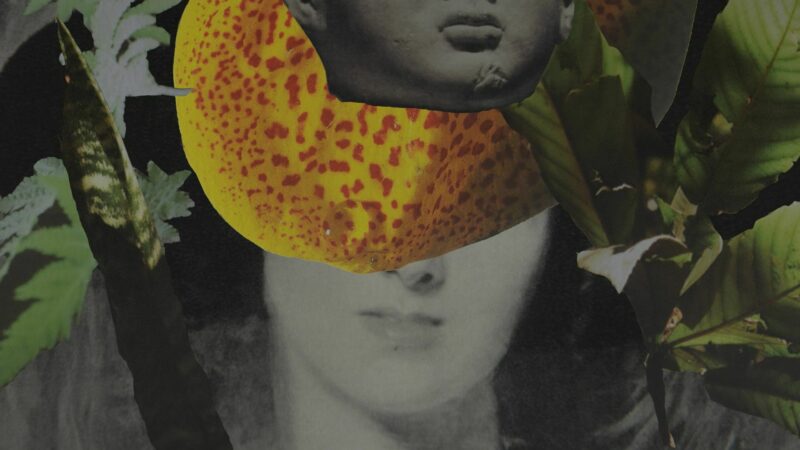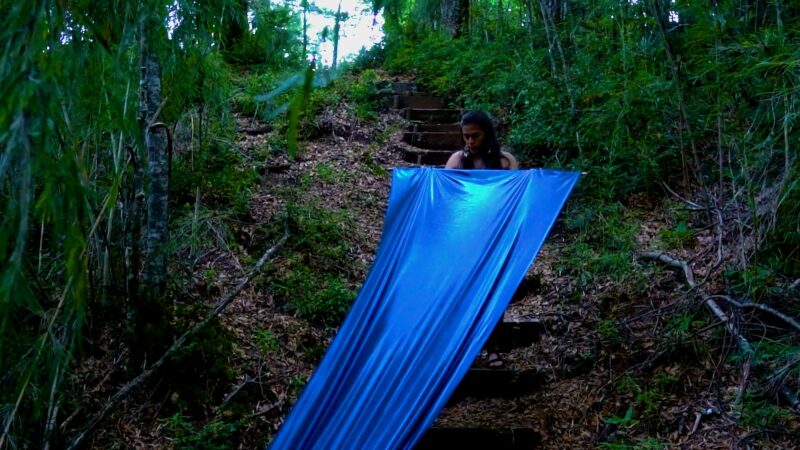Première canadienne
Le deuxième sexe : sur les traces de Simone de Beauvoir
Nathalie Masduraud, Valérie Urréa
 Bande-annonce
Bande-annonce
Disponible en ligne du 21 - 30 mars 2025 sur ARTS.FILM
Au fil d’un road-trip aux États-Unis, où “Le deuxième sexe” trouva sa genèse, un regard inédit sur l’ouvrage pionnier de Simone de Beauvoir, nourri par les analyses de théoriciennes féministes qui en mesurent la portée et les limites.
En 1949, la parution du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir provoque une onde de choc : un plaidoyer de mille pages pour l’égalité des sexes, l’indépendance des femmes et la libération des mœurs. Pour la première fois, une femme livre une analyse inédite et mordante des mécanismes de domination masculine dans une société d’après-guerre que l’on n’appelle pas encore patriarcale. Le scandale sera immense ; le succès, planétaire. On le sait peu, mais c’est aux États-Unis, à l’occasion d’une tournée de conférences entreprise en 1947, que Simone de Beauvoir trouva l’inspiration pour écrire Le deuxième sexe. Quatre mois durant, elle observe d’un œil d’entomologiste les attitudes des jeunes filles de bonne famille, s’étonne du corsetage des New-Yorkaises, s’indigne de la soumission des femmes mariées, et découvre, sidérée, la brutalité d’un Sud ségrégationniste. “C’est étrange et c’est stimulant de découvrir soudain à 40 ans un aspect du monde qui crève les yeux et qu’on ne voyait pas”, dira l’autrice sur la genèse de son essai. “Je m’étais mise à regarder les femmes d’un œil neuf et j’allais de surprise en surprise.” Ses réflexions, notées dans un carnet, nourriront amplement l’écriture de son ouvrage.
Voyage initiatique
Soixante-quinze ans plus tard, comment se mesure l’impact de ses idées avant-gardistes ? Comment la phrase culte “On ne naît pas femme, on le devient” a‑t-elle fait voler en éclats des siècles de domination patriarcale et poser les bases des théories les plus contemporaines, comme celles du genre et de l’écoféminisme ? Imaginé comme un voyage initiatique aux origines de la pensée de Simone de Beauvoir, le film de Nathalie Masduraud et Valérie Urrea (Alice Guy – L’inconnue du 7e art, la série H24) nous entraîne à travers les États-Unis, sur les lieux qui ont inspiré la philosophe et nourri ses théories. Une quête intime et politique qui donne corps aux écrits de la philosophe, talentueusement “interprétés” par Noémie Merlant. Et une réflexion accompagnée par de grandes penseuses féministes de notre siècle – Judith Butler, Laure Murat, Silvia Federici, Kellie Carter Jackson, Caitlin Keliiaa et Françoise Vergès –, qui analysent ici les fulgurances, mais aussi les limites et les points aveugles de cette “bible du féminisme”.
En présence de la réalisatrice Valérie Urréa le 19 mars à Montréal.
En 1949, la parution du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir provoque une onde de choc : un plaidoyer de mille pages pour l’égalité des sexes, l’indépendance des femmes et la libération des mœurs. Pour la première fois, une femme livre une analyse inédite et mordante des mécanismes de domination masculine dans une société d’après-guerre que l’on n’appelle pas encore patriarcale. Le scandale sera immense ; le succès, planétaire. On le sait peu, mais c’est aux États-Unis, à l’occasion d’une tournée de conférences entreprise en 1947, que Simone de Beauvoir trouva l’inspiration pour écrire Le deuxième sexe. Quatre mois durant, elle observe d’un œil d’entomologiste les attitudes des jeunes filles de bonne famille, s’étonne du corsetage des New-Yorkaises, s’indigne de la soumission des femmes mariées, et découvre, sidérée, la brutalité d’un Sud ségrégationniste. “C’est étrange et c’est stimulant de découvrir soudain à 40 ans un aspect du monde qui crève les yeux et qu’on ne voyait pas”, dira l’autrice sur la genèse de son essai. “Je m’étais mise à regarder les femmes d’un œil neuf et j’allais de surprise en surprise.” Ses réflexions, notées dans un carnet, nourriront amplement l’écriture de son ouvrage.
Voyage initiatique
Soixante-quinze ans plus tard, comment se mesure l’impact de ses idées avant-gardistes ? Comment la phrase culte “On ne naît pas femme, on le devient” a‑t-elle fait voler en éclats des siècles de domination patriarcale et poser les bases des théories les plus contemporaines, comme celles du genre et de l’écoféminisme ? Imaginé comme un voyage initiatique aux origines de la pensée de Simone de Beauvoir, le film de Nathalie Masduraud et Valérie Urrea (Alice Guy – L’inconnue du 7e art, la série H24) nous entraîne à travers les États-Unis, sur les lieux qui ont inspiré la philosophe et nourri ses théories. Une quête intime et politique qui donne corps aux écrits de la philosophe, talentueusement “interprétés” par Noémie Merlant. Et une réflexion accompagnée par de grandes penseuses féministes de notre siècle – Judith Butler, Laure Murat, Silvia Federici, Kellie Carter Jackson, Caitlin Keliiaa et Françoise Vergès –, qui analysent ici les fulgurances, mais aussi les limites et les points aveugles de cette “bible du féminisme”.
En présence de la réalisatrice Valérie Urréa le 19 mars à Montréal.
Autre festival :
DOC NYC, États-Unis (2024)
DOC NYC, États-Unis (2024)
| Réalisation | Nathalie Masduraud, Nathalie Urréa |
| Montage | Sylvie Bourget, Valérie Loiseleux |
| Montage son | Rym Debbarh-Mounir |
| Son | Graciela Barrault |
| Mixage | Vincent Verdoux |
| Musique | Léonie Pernet |
Séances
• Musée national des beaux-arts du Québec (à Québec)
Mardi 18 mars 2025, 13:15 — 14:47
• Office national du film du Canada - Salle Alanis-Obomsawin
Mercredi 19 mars 2025, 19:00 — 20:32
Réalisation

Nathalie Masduraud
Nathalie Masduraud, formée à la Fémis, est active depuis les années 90. Elle réalise des documentaires, en particulier des portraits d’artistes, notamment d’Ella Fitzgerald et de Françoise Sagan. Valérie Urrea et Nathalie Masduraud réalisent leur premier film ensemble en 2014, “Afrique du sud — Portraits chromatiques”, un documentaire dédié à la scène photographique sud-africaine produit par Arte, et accompagnée d’une mini-série. On retrouvera d’ailleurs le thème de la photographie dans leur film suivant, “Focus Iran, l’audace au premier plan” (2017), consacré à la jeune scène iranienne dont le portrait, à travers le prisme de la pratique photographique, se prolongera dans la web-série “Iran#NoFilter”.
Notes biographiques fournies par l’équipe de film
Notes biographiques fournies par l’équipe de film

Valérie Urréa
Valérie Urrea réalise des documentaires sur des sujets de société comme les questions de genre, raciales ou de handicap. Elle s’intéresse également à la danse, en signant plusieurs films sur la chorégraphe Mathilde Monnier. Valérie Urrea et Nathalie Masduraud réalisent leur premier film ensemble en 2014, “Afrique du sud — Portraits chromatiques”, un documentaire dédié à la scène photographique sud-africaine produit par Arte, et accompagnée d’une mini-série. On retrouvera d’ailleurs le thème de la photographie dans leur film suivant, “Focus Iran, l’audace au premier plan” (2017), consacré à la jeune scène iranienne dont le portrait, à travers le prisme de la pratique photographique, se prolongera dans la web-série “Iran#NoFilter”.
Notes biographiques fournies par l’équipe de film
Notes biographiques fournies par l’équipe de film
Vous aimerez aussi